Un nouveau témoignage… 

 Moi
Moi,
conseiller dans une agence bancaire, je travaille dans l’une des
grandes banques françaises, comme conseiller aux particuliers. Le poste
est accessible dès Bac+2.
Je précise que je ne me destinais pas à cette branche, ayant un
diplome en gestion de patrimoine, mais comme tant d’autres jeunes j’ai
pris ce qu’il y avait à prendre..
L’année de travail est rythmée par des challenges commerciaux. Avant
mon arrivée, jusqu’au milieu des années 2000, ils duraient 2 mois ; et
étaient entrecoupés de 15 jours off. Aujourd’hui, ils durent 4 mois, et
ne s’arrêtent qu’entre fin juillet et début septembre.
L’année, donc le temps, sont constamment rythmés par cette course aux
résultats, qui met chacun en concurrence avec ses voisins. Et maximise
le résultat global en maintenant perpétuellement les moins bien classés
sous pression. Celà ne crée certes pas de Troubles
musculo-squelettiques, mais c’est usant à la longue.
La quasi totalité des produit sont quantifiés, sur un objectif final à
réaliser à terme, et un plan de marche quotidien à respecter pour
l’atteindre : épargne logement, assurance vie, collecte (faire entrer
plus d’argent qu’il n’en sort), prévoyance, assurances, comptes
courants,…
La course ne s’arrête jamais. Et maintient l’espace temps dans un court termisme absolu.
Parce qu’il faut non seulement reussir l’objectif final, mais aussi
être “dans le vert” (respecter le plan de marche au jour le jour), sur
le fichier excel de votre n+1/n+2. Et ça sur tous les compteurs comme
ils disent, idéalement.
Je suppose que les objectifs annuels sont tout bonnement divisés par
le nombre conseillers, et “saisonnalisés” selon les priorités du moment.
“Conseiller” est d’ailleurs un terme plutôt destiné à la communication externe. En interne, nous sommes appelés “vendeurs”.
Quoi qu’il en soit, l’obtention de bons résultats pour chaque
supérieur hiérarchique, du sommet à la base, dépend de l’atteinte de
leurs objectifs par ses subordonnés directs.
Pas forcément révolutionnaire cette organisation. Mais insidieuse,
car la pression s’accroît plus on descend dans la hiérarchie. D’autant
qu’à chaque échelon les collaborateurs sont également en concurrence
entre-eux. Ce qui incite mécaniquement à des comportements peu vertueux
vis-à-vis du public, voire même dangereux pour l’entreprise elle-même.
Car seule l’obtention de (très) bons résultats dans la durée peut
vous permettre d’accéder à l’échelon suivant. Pour un conseiller, celà
signifie être régulièrement aperçu dans les 15/20 premières places sur
au moins 12 à 18 mois. Et produire un chiffre d’affaires considérable.
Nous sommes ainsi par exemple lourdemment incités à “compléter”
l’ouverture d’un compte courant ou un changement de carte bleue par la
vente d’assurances additionnelles. Celles-ci ne sont pas intégrées au
package de base, et donc non obligatoires. Mais la consigne est répetée
lors des réunions commerciales.
Curieux, quand dans le même temps une des devises commerciales de
l’établissement indique que l’intérêt de la banque passe après celui du
client.
Concrètement, il s’agit d’annoncer au client le prix assurance
incluse, à charge pour lui de comprendre qu’elle n’est dans les faits
qu’optionnelle… Pas mal.
Concernant la bourse, les dirigeants ont bien compris l’aversion au
risque intrinsèque à l’épargnant “moyen” français, ainsi que son
potentiel manque de réactivité face à la volatilité des indices. Surtout
depuis que la maison a eu quelques démêlés judiciaires dans ce domaine.
Dorénavant, il sort en moyenne chaque année un ou deux produits de type : fonds à promesse.
Le capital y est garanti à une échéance qui varie de 4 à 8 ans quoi
qu’il arrive. La performance dépend des résultats sur la période, de
l’indice de référence. Qui peut être un indice (Cac 40), ou un panier
d’indices. Si l’indice de référence est positif à terme, le rendement le
sera aussi, mais dans une fourchette déterminée à l’avance. Le
rendement est nul ou quasi si l’indice est stable ou négatif. Mais si
l’épargnant a besoin de tout ou partie de la somme avant échéance, il
sort au cours du jour (donc potentiellement en perte), et perds de facto
4% de pénalité sur le capital investi.
Si comme moi vous lisez régulièrement avec plaisir Olivier, ou
d’autres (Paul Jorion par exemple), vous savez que mettre en quarantaine
plusieurs milliers d’euros sur le marché action à l’heure actuelle est
probablement sensiblement témeraire.
Et ce d’autant plus si le client investisseur n’a que pas ou peu
d’épargne facilement disponible par ailleurs. Mais si la direction a
décidé de mettre l’accent sur ce produit (ou que le n+2 a décidé de “se
montrer” pour consolider son évolution future), il va bien falloir
“produire”. Tant pis pour ceux qui auront besoin de leur argent en cours
de route. Ou qui s’apercevront dans 6 ans que, compte tenu de la chute
de l’indice, ils y ont gagné moins que rendement d’un livret A…soit
moins que l’inflation!!
Les reportings sont un bon moyen de coercition. Comme dans beaucoup
d’entreprises, les managers sont debriefés chaque semaine, et font de
même avec leurs subordonnés.
Mais quand les choses vont mal au classement, les choses
s’instensifient. On peut vous appeler/convoquer tous les jours pour
savoir où vous en êtes. Vous envoyer en session de rattrapage accélérée,
pour vous remettre sur les rails. Vous imposer des séances de phoning,
pour avoir plus de grain à moudre ensuite ; et vous y superviser
physiquement. Parce qu’il y a évidemment un nombre minimal de rdv à
effectuer sur la semaine.
Normal me direz-vous, qu’on ne soit pas payé à rien faire. Sauf qu’il
ne s’agit pas selon moi de conseil tel qu’on pourrait le concevoir
naïvement. C’est simplement statistique. Plus vous avez d’opportunités,
plus vous produirez. Régulièrement en retrait commercialement, vous
pouvez faire une croix sur toute forme d’évolution. Mais à terme, c’est
votre place même qui peut être en danger.
Alors oui, les résultats sont globalement obtenus. De toutes les
façon si vous n’êtes pas content, vue la situation du marché de l’emploi
vous n’êtes pas franchement en position de vous rebeller ; ce qu’ils
ont bien compris croyez-moi. Et, entre-nous soit dit, ça semble être peu
ou prou la même chose ailleurs.
Mais si vraiment l’effondrement final doit avoir lieu, avec le
cataclysme boursier qu’on peut imaginer, ou seront les managers qui ont
préconisés ce fonds dans 4/5 ans ? Promus, soit sur un meilleur
emplacement au même grade, soit dans les hautes sphères de la banque.
Les conseillers eux seront passés directeurs d’agences, ou conseiller
pro. Chacun aura (selon son grade) tiré profit
financièrement/professionnellement de l’opération.
Simplement, la vraie gestion de portefeuille nécessite un suivi long
terme; d’autant plus si le produit ne permet de sortie qu’à 4, 6, ou 8
ans. Mais la multiplication des objectifs et autres campagnes
commerciales, le volume d’activité et les contraintes administratives
(reporting) peuvent rendre ce suivi délicat.
L’obsession du court terme, encore et toujours.
Et la mobilité (interne ou externe) inhérente à notre marché du travail actuel.
J’ai vu des clients littéralement s’effondrer dans mon bureau. Les
autres, la majorité, sont à la fois résignés et pleins de colère,
presque épidermique chez certains, dès que le sujet est abordé.
Ils ont pour la plupart investis en haut de la désormais fameuse
bulle Internet du début des années 2000. Ou au milieu des années 2000,
peu avant le début du grand chambardement actuel. Bien garnis leurs PEA
et comptes-titres, encouragés par leurs conseillers de l’époque,
eux-mêmes largemment poussés à faire “profiter de rendements
intéressants” à leur client. Aujourd’hui, les clients pleurent quand je
leur annonce qu’ils n’ont que deux solutions:
- faire le dos rond en attendant une hypothétique remontée (de l’inflation?? Ça oui peut-être..)
- basculer en fonds euros, pour regagner sa mise, déduction faite des
droits d’entrées, en disons…12 ans?? (“Bah oui Mme, c’est du 3% par
an…”)
Mais en réalité, je ne suis moi-même là que pour leur vendre le dernier rejeton du produit en question!!
Ou autre chose. Tout ce que je pourrai en fait.
Ici aussi, rien n’a changé.
Les stratégies du top managment ces derniers mois m’ont également mis la puce à l’oreille.
Les lecteurs assidus que nous sommes de ce blog savons qu’en réalité
l’édifice financier entier est moribond depuis 2008. Donc eux le savent
aussi, énarques de leur état.
Comment un tel fiasco a-t-il bien pu se produire?? Quid de la suite sur cette branche d’activité?
Je suis comme vous, informé par le web… Là-dessus, no comment.
Ca laisse le sentiment diffus d’une grande précipitation, voire d’un aveuglement financier bien connu..
Plus récemment, il a été décidé d’appliquer une tarification
forfaitaire aux comptes courants dits inactifs, c’est-à dire sans
opération sur au moins 12 moins consécutifs. La modification, applicable
quelques mois plus tard, a été imposée aux clients via l’envoi d’un
simple courrier, et n’a même pas été concertée avec la base. C’était
soit ça soit clôturer volontairement son compte. Sympa! Comme souvent
dans ce cas de figure, nous recevons (après coup) un argumentaire type à
rétorquer en cas de contestation. Nous l’avons donc découvert sur le
tas.
Pour information, il s’agit dune multiplication unilatérale du prix annuel par 10…
L’affaire a évidemment fait du bruit. Le bouche à oreille, avec les
réseaux sociaux et autres associations de consommateurs, ça peut aller
si vite. A tel point que la banque a dû se dédire publiquement, allant
même jusqu’à remettre en cause le tarif initialement imposé, et
l’importance même du courrier. (!)
Personnellement j’ai “perdu” 50 000€ d’objectifs sur mon portefeuille dans cette histoire.
Si la même mésaventure est arrivée à plusieurs collègues face à des
clients mécontents, ce sont facilement des sommes astronomiques qui
s’évaporent instantanément du bilan de la banque.
Et rendent aussitôt la réalisation des objectifs (de collecte)
hypothétique. Si vous connaissez beaucoup de commerçants capables de
faire passer une aussi grosse pilule facilement, appelez-moi.
Qui a décidé des objectifs? Le board.
Qui a décidé d’augmenter si soudainement les tarifs? Le board.
Qui viendra me tancer si jamais je ne réalise pas mes objectifs? Le même board..
Résultat des courses : l’augmentation tarifaire (donc le gain
escompté) s’éloigne, au moins temporairement,mais
commercialement/médiatiquement le mal est bel et bien fait. On dit merci
qui?
Ce même board accueille depuis quelques temps l’un des ex-dirigeants d’une des plus prestigieuses banques étrangères.
Ici aussi, on voit que “rien n’a changé”.
En faillite en 2008 à cause des prêts toxiques, la valeur de l’action
de cette banque s’est effondrée à ce jour de plus de 95% sur les 5
dernières années.
Si le Pdg de l’époque est bien parti avec environ 700k€ de primes, il
y a aussi eu 9000 postes détruits. Tout ceci a bien évidemment coûté
des dizaines de milliards au contribuable local ; puisque la banque a
été nationalisée. Et là aussi , soit dit en passant, on a socialisé les
pertes (après avoir privatisé les profits pendant les belles années).
Du coup, je suis devenu plus ou moins imperméable à ces discours
moralisateurs parlant d’efforts, de courage, de mérite ou encore de
responsabilité.. Qu’ils me soient appliqués individuellement dans mon
travail, ou qu’ils concernent plus généralement la
sévère dérégulation (accélérée) en cours sous nos yeux un peu partout,
d’ailleurs.
Car ici aussi il faut “réduire les coûts”.
Mon agence a perdu deux postes de conseillers en seulement quelques
années. Dans les grandes agglomérations, les agences ont été fusionnées
deux par deux. Celà permet d’économiser sur les doublons ; notamment de
ne payer qu’un seul directeur plutôt que deux. Le “survivant”, sera
secondé sur le terrain par un collaborateur non cadre, chargé en clair
de faire tourner la boutique quand le directeur est absent. Pratique le
collaborateur, il assure et, même légèrement promu, coûte deux fois
moins à l’entreprise.
De très nombreux départs ne sont pas remplacés. Des services
externalisés. Ce qui altère mécaniquement, soit la qualité du service,
soit le bien-être des collaborateurs.
Sur la partie non bancaire, le guichet public a été refait 3 fois sur
les dernières années. De 5 positions de travail, il est passé à 4, puis
2, puis 1. En tout juste 6 ans ! Chapeau.
J’appelerais celà l’allégorie de la grenouille pour ceux qui
connaissent. Ce guichet dorénavant unique est de plus en plus
intermittent. Régulièrement fermé une voire deux heures avant l’heure
officielle. Nous disons “panne informatique” là ou il faudrait dire :
pas de personnel. Ou plus exactement: pas de volontaires pour assumer, à
ses frais, les conséquences d’une réorganisation dont il sort
individuellement plus perdant que bénéficiaire. Un guichetier non
bancaire est embauché au Smic.
Certains clients mécontents nous traitent alors de nantis, feignants,
etc Comique, alors que leur inconfort a pour cause une vision
rationnelle des coûts.
Toujours sur le non bancaire, le samedi est devenu le jour de
l’étudiant. Ils sont de plus en plus à venir en extra, faire le
travail. Ils sont aux côtés de stagiaires et intérimaires, eux aussi en
expansion. Parfois 3 ou plus simultanément ! Pratique, la boutique
tourne avec des stagiaires qui coûtent entre 400 et 500 euros par
mois. Les intérimaires eux sont renouvelables au mois.
Ah, le coût du travail…
Symboliquement, et très visuellement, la vente y est devenue
l’essentiel de l’activité, au détriment du service d’intérêt
général. Ces derniers temps je constate que ma propre rémunération
variable semble se corréler inversement à la pression subie.
L’endroit où se créée facilement le précédent, la brèche, qui sera
ensuite généralisée à toutes les catégories (cf les retraites).
Non, pas de quatorzième mois. Le treizième? J’aurais bien aimé.. 200€ d’intéressement et puis s’en va…
Ma banque ne fonctionne pas différement du modèle que la finance
généralise dans toute la société. Dérégulation pour tout horizon. Course
à la performance individuelle, soi-disant synonyme
d’enrichissement futur. Cet enrichissement ne concerne en réalité que le dernier décile.
Nous autres ne sommes qu’un indispensable marchepied. Joli jeu de dupes.
Tout ceci est subtilement mené, mettant progressivement la population devant le fait accompli.
Plus problématique: l’énorme majorité n’y voit encore que du feu, continuant de s’en prendre plutôt à son voisin.
Signé : un lecteur du blog…





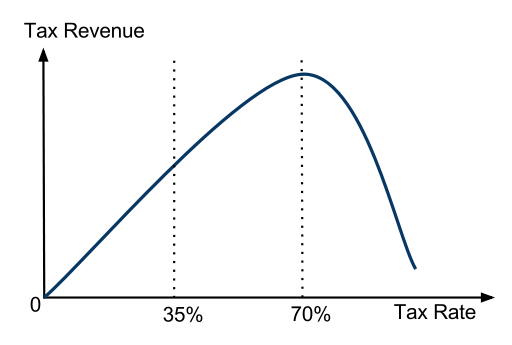



 Moi,
conseiller dans une agence bancaire, je travaille dans l’une des
grandes banques françaises, comme conseiller aux particuliers. Le poste
est accessible dès Bac+2.
Moi,
conseiller dans une agence bancaire, je travaille dans l’une des
grandes banques françaises, comme conseiller aux particuliers. Le poste
est accessible dès Bac+2.
 - Une usine de Chandigarh. REUTERS/Ajay Verma. -
- Une usine de Chandigarh. REUTERS/Ajay Verma. -